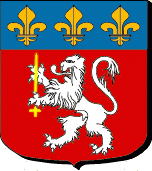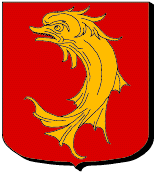Le Principe Monarchique
« Comprenons que le salut ne saurait être dans le mépris du droit; et, nous attachant plus fermement que jamais au principe monarchique, répétons la vieille devise si chrétienne et si française : Fais ce que dois, advienne que pourra. »
Deryssel, Mémoire sur les droits de la Maison d’Anjou à la Couronne de France.
Introduction
Montesquieu, dans son célèbre livre De l’Esprit des lois distingue trois modes de gouvernement, reposant chacun sur un principe :
• d’abord le despotisme, qui a pour principe la crainte ou la peur;
• ensuite la république, reposant sur la vertu;
• et enfin la monarchie, qui quant à elle repose sur l’honneur.
Montesquieu est bien sûr partisan de la monarchie, mais, dans la tendance libérale, il est partisan d’une monarchie constitutionnelle qui respecterait la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il faudrait donc dans ce cas parler de royauté plus que de monarchie.
En effet, le monarque regroupe par définition ces trois pouvoirs, et sous l’Ancien Régime, une telle séparation eût été artificielle.
Pour notre étude, un point de départ tout simple pourrait être le Petit Robert : ce dictionnaire définit ainsi la monarchie : « Régime dans lequel l’autorité politique réside dans un seul individu (monarque); État gouverné par un seul chef, spécialement par un roi héréditaire. » Et nous pourrions y opposer la définition de république : « forme de gouvernement où le pouvoir et la puissance ne sont pas détenus par un seul, et dans lequel la charge de chef de l’État n’est pas héréditaire »; voire celle de démocratie : « doctrine politique d’après laquelle la souveraineté doit appartenir à l’ensemble des citoyens; organisation politique (souvent la république) dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté ».
Donc, le monarque a seul autorité politique, comme le roi Louis XVI nous en porte témoignage : « Il est de l’essence de mon autorité, non d’être intermédiaire, mais en tête », et plus encore saint Louis qui affirmait « Nous voulons que soit étroitement gardée et retenue à nous la plénitude de la puissance royale ».
Est-ce à dire que le monarque a pouvoir sans limite ? Presque évidemment, comme nous le verrons pour commencer, mais presque seulement, ainsi que le résume Montesquieu lorsqu’il écrit que dans la monarchie « un seul gouverne par les lois fondamentales », qui sont un frein à l’autoritarisme, de même que les instances de conseil. De fait, la monarchie est un système équilibré, et donc toujours d’actualité. J’irais même jusqu’à dire que c’est le seul système qui puisse garantir la stabilité et la solidité nécessaires à une société, et ainsi le seul système qui puisse être d’actualité. Il est par conséquent très important d’en connaître ses principaux rouages, et d’avoir une idée assez précise de ce qu’est le principe monarchique, tant dans son application que dans son contrôle, en quelque sorte ses gardes-fous.
Un pouvoir presque illimité
Pouvoir législatif
Jean Bodin (1530-1596), qui fut avocat au parlement de Paris, lieutenant général, puis procureur du roi au bailliage de Laon, écrivait dans Les six livres de la république que « le point principal de la majesté souveraine et puissance absolue gît à donner des lois aux sujets en général, sans leur consentement ».
Donc le monarque (que j’appellerai indifféremment monarque ou roi puisque en France le roi était monarque) est seul a donner des lois. Il a le monopole de la législation, ou plus précisément de la législation ordinaire, dans la mesure où il ne peut par contre pas toucher de lui-même aux lois fondamentales du royaume. Toujours est-il que la législation ordinaire est déjà très vaste. Et ce monopole qu’il détient explique des formules, à la fin des édits ou des ordonnances, comme : « car tel est notre plaisir », ou encore que la Charte constitutionnelle de 1815 soit « octroyée » par Louis XVIII, et non obtenue par le peuple.
Le roi est ainsi centre de la loi, et le système monarchique français entérine l’application d’une maxime inventée pour l’empereur romain : « tout ce qui plaît au prince à force de loi ». Nous pouvons d’ailleurs retrouver cette dernière dans la bouche de certains penseurs français, à l’image du sénéchal du Poitou Beaumanoir (1246-1296) qui nous enseigne que « ce qu’il lui plaît de faire doit être tenu pour loi ».
Ainsi, nous pouvons nous rendre compte que ce n’est pas là un mince pouvoir, et nos rois avaient eux aussi conscience de l’importance de cette attribution. Par exemple le roi Louis XV, dans un édit de décembre 1770, déclarait que « le droit de faire des lois par lesquelles les sujets doivent être conduits et gouvernés appartient à nous seul et sans partage ».
Ce pouvoir n’est en général pas contesté, y compris par les parlements ou instances de conseils. Ainsi, le Parlement de Paris affirmait au même Louis XV, lors d’une séance de janvier 1771 que « Le droit de faire des lois n’appartient qu’à vous seul, sans dépendance et sans partage ». Voilà qui pourrait sembler curieux, d’autant plus que les Français n’ont pas la réputation d’abdiquer facilement une parcelle de pouvoir, mais en fait laisser ce pouvoir législatif entre les mains du roi est déjà le moyen de se dédouaner et de lui en laisser la responsabilité, et il est aussi bien logiquement plus facile de faire confiance à un homme, qui n’a d’autre possibilité que d’œuvrer pour la « Res Publica », qu’à quelques centaines de personnes, choisies plus ou moins efficacement, plus ou moins selon leurs compétences, mais qui de toutes façon seront incapables de se mettre d’accord sur quelque loi que ce soit. En témoignent encore aujourd’hui les dizaines d’amendements généralement nécessaires, d’Assemblée en Sénat et de Sénat en Assemblée, afin que puisse passer une loi qui de fait n’a plus rien à voir avec le projet initial… Nous pouvons de plus immédiatement ajouter que quelques centaines de personnes qui doivent se mettre d’accord, sans le pouvoir évidemment, ne seront par conséquent non plus soumises à la « Res Publica », au sens positif du terme évidemment, mais à la loi de la majorité, qui généralement s’éloigne de cette dernière. Le monarque a donc là un avantage certain, tant par son indépendance que par sa nécessaire soumission au Bien Commun. Et les parlements d’Ancien Régime, qui n’étaient pas encore corrompus par la doctrine démocratique telle que nous l’entendons aujourd’hui, en avaient bien conscience.
A noter que la législation ordinaire correspond au droit public évidemment, mais aussi au droit privé. Cependant, nos monarques ont toujours fait preuve d’un esprit de modération en ce dernier domaine, et pendant longtemps, ils ont préférer ne pas intervenir dans le droit privé, laissant aux populations le soin de fixer leurs coutumes (pour rappel, la coutume est une loi qui s’est imposée par adhésion volontaire de chacun); et ce n’est qu’avec la croissante centralisation que ces dernières ont été mises à l’index.
Par contre, comme je l’ai dit précédemment, le roi ne peut pas changer de lui-même les lois fondamentales du royaume. Sixte de Bourbon-Parme nous en donne une définition générale : « On désigne en général de ce nom certaines règles fixes, que le droit public français a placé au-dessus de la volonté souveraine. Ce sont les règles intangibles qui furent invoquées au cour des âges, quand les graves difficultés se présentaient : on voyait en elles le fondement même de la monarchie » (in Le Traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume). En effet, leur élaboration découle de la volonté concordante du roi et de la nation en général. Par exemple, regardons sommairement la loi de catholicité. Elle a déjà été énoncée dans un édit pris le 19 juillet 1588 à Rouen par Henri III certes, mais en fait, ce ne fut alors que la réaffirmation d’un principe soutenu par la nation aux États généraux de Bois de 1576, puis par la Ligue dans son manifeste du 31 mars 1585. Et les États généraux de nouveau réunis à Blois en 1588 reconnaissent en l’édit de Rouen une loi fondamentale, comme l’explique Bernard Basse, que j’ai déjà souvent cité dans de précédentes conférences. Volonté commune du roi et des sujets donc, dans une sorte de partie de ping-pong en trois coup qui peut sembler complexe, mais au combien moins complexe que le jeu de squash entre nation, Assemblée, Sénat, gouvernement avec ou sans chef de l’État selon cohabitation et modalités électorales…
Toujours est-il que le pouvoir législatif du monarque, quoique n’allant pas jusqu’aux lois fondamentales, est traditionnellement très étendu. Mais son pouvoir ne s’arrête évidemment pas là.
Pouvoir exécutif
Le deuxième pouvoir détaché par Montesquieu est le pouvoir exécutif.
Et celui du roi n’est pas moins important que son pouvoir législatif.
Le marquis d’Argenson, au XVIIIème siècle, résume très bien à quoi il doit correspondre : « un bon roi doit régler par lui-même les principales affaires de son État, les premières immédiatement, les secondes par un pouvoir émané et délégué », sachant que « les officiers royaux sont ceux qui n’agissent dans leurs fonctions qu’au nom du roi et qui le représentent en cela. Toute l’administration dans le détail du gouvernement, pour avoir le meilleur succès, doit être conduite par le roi, ou au nom du roi par les officiers qui le représentent ». Jean Bodin, que j’ai citer au début de ma conférence, ajoute qu’ « il n’appartient qu’au souverain d’octroyer privilèges, exemptions, immunités et dispenses des édits et ordonnances, encore que les privilèges en monarchie n’aient trait que pour la vie du monarque ».
Ceci est somme toute très logique : celui qui fait les lois doit posséder les moyens de les mettre en oeuvre. Car à quoi servirait de faire des lois que nul n’appliquerait, sinon à faire de la France un État de non-droit exclusif ?
Là encore, nos rois avaient conscience de l’importance de ce pouvoir, à l’image du roi Henri IV [cité par Kunstler, dans La Politique de nos rois] disant à M. de Chessac, second président du parlement de Bordeaux, le 3 novembre 1599: « J’ai en main de quoi faire repentir ceux qui voudront s’opposer à mes commandements. J’ai fait un édit, je veux qu’il soit observé. Et quoi que ce soit, je veux être obéi ». Il disait encore au Parlement de Paris le 7 février 1599 : « Je couperais la racine à tous les factieux… Je suis roi maintenant et parle en roi. Je veux être obéi… Faîtes ce que je vous commande au plus tôt. » Voilà qui contraste avec nos actuels chefs de l’État, qui n’ont de chef que le nom.
Rappelez-vous ma conférence sur l' »alliance du Trône et de l’Autel », pour ceux qui y ont assisté : Dieu laisse la France en dépôt au roi. Charge à ce dernier d’être un bon gestionnaire, dans le sens du Bien Commun.
Le roi doit avoir un rôle d’administrateur en son pays, et donc il doit aussi avoir à disposition tous les moyens matériels ou juridiques nécessaires pour assurer la prospérité du royaume. Et ça lui est évidemment beaucoup plus facile que dans le système actuel où le président peut avoir à gouverner avec une Assemblée, détenant le pouvoir législatif, qui lui est opposée, voire un gouvernement qui n’est pas « de son bord ». De fait, tout président qu’il est il ne préside pas grand chose, et notre bien-aimé Chirac Ier, après sa magnifique dissolution de 1997, en est un splendide témoignage.
Qui plus est, dans le cadre de la monarchie, le pouvoir exécutif n’est pas partagé. Sous l’Ancien Régime, le partage de ce pouvoir entre le Chef de l’État et le premier ministre, avec une répartition des champs de compétence, n’aurait eu aucun sens. Même quelqu’un comme Richelieu n’avait pas de pouvoir de décision sur Louis XIII. C’était tout au plus un pouvoir de conseil, voire de simple application des directives du souverain.
Alors, pourquoi le marquis d’Argenson nous parlait-il tout à l’heure d’un « pouvoir émané et délégué » ? Le bon gouvernant est en effet celui qui sait déléguer, et utiliser les compétences de chacun. C’est aussi celui qui sait s’appuyer sur les corps existant, comme famille, et nous rejoignons ici les fondements du principe de subsidiarité. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques minutes.
Pouvoir judiciaire
Troisième et dernier pouvoir que distingue Montesquieu est le pouvoir judiciaire.
Nous pourrions d’emblée dire de lui qu’il est le plus traditionnel dans la monarchie française. Qui n’a jamais vu de gravure représentant saint Louis rendant justice ? Nous pouvons encore croiser une permanence de ce pouvoir pour le président dans son droit de grâce.
Le Chancelier Michel de l’Hospital (v.1504-1573) disait en ce sens que « le principal office des rois est de faire justice… C’est la justice seule qui donne le nom à son royaume »
Là encore, c’est assez logique, et dans la continuité de tout ce que j’ai dit : celui qui exécute doit être en mesure de sanctionner celui qui n’obéit pas, c’est à dire celui qui rompt l’ordre public.
En effet, si le gouvernant n’a pas le contrôle du pouvoir judiciaire et que celui qui détient ce dernier pense comme lui, alors il n’y a certes pas de problème : gouvernant et juge s’entendrons. Mais s’il n’y a pas concordance de vues, alors inexorablement le système devient bancal. L’actualité récente nous prouve que ça peut être encore pire car les déboires de l’ancien maire de Paris aujourd’hui président sans pouvoirs divisent constitutionalistes et juges, constitutionalistes entre eux, et de même juges entre eux… Nous sommes ici bien loin de la sérénité nécessaire à l’exercice du pouvoir déjà, mais ces scandales nous montrent aussi le peu de crédibilité de la « République démocratique » actuelle. Là-encore, la monarchie sort la tête haute, et, comme pour les pouvoirs législatif ou exécutif, nos rois ont toujours été fidèles à ce principe. Citons encore Henri IV, qui écrivait au duc de Chevreuse dans une lettre datée du 21 novembre1590 que « les rois sont établis pour rendre justice ».
Évidemment, je ne veux pas dire que le roi peut faire ce qu’il veut ou que les juges sont inutiles (le roi doit déléguer, rappelons-le). Par exemple, les Parlements exécutaient jadis la justice du roi. Mais le monarque doit venir en dernier recours; il doit être en quelque sorte l’arbitre suprême dont nous avons besoin pour trancher lorsque nul n’est capable de le faire.
Ajoutons que le roi pouvait bien évidemment rendre grâce, par ce qui est appelé les « lettres de grâce ». Comme je le disais, on en a la continuité aujourd’hui. Mais il faut tout de même préciser que nos rois n’en ont jamais abusé.
Pourquoi ce pouvoir était-il traditionnellement si important ? Probablement parce que rendre justice était un des engagements du sacre. « Je maintiendrai la justice avec l’aide du Seigneur, comme il appartient au roi de l’assurer en son royaume », doit déclarer le souverain devant Dieu. Et lorsque bâton et sceptre lui sont remis, l’officiant déclare : « Accepte la tige de vertu et d’équité, avec laquelle tu sauras aider les hommes pieux et effrayer les méchants, remettre sur la bonne voie les égarés, tendre la main à ceux qui tombent, rabattre l’orgueil des superbes, et relever ceux qui sont à terre,[…]baguette de justice, baguette de ton règne.[…]Aime la justice. »
Ainsi, le monarque détient un pouvoir très fort, quasi-illimité, mais nous allons voir immédiatement que, qui dit quasi-illimité, dit limité quand même.
Quelques limites
L’importance des Lois fondamentales du royaume
Bernard Basse, dans la Constitution de l’Ancienne France, définit la légitimité comme « l’ensemble des lois et principes fondamentaux qui mettent un frein à l’omnipotence royale. C’est le contrepoids de l’absolutisme et l’antidote de l’arbitraire. La royauté française apparaît comme une monarchie légitime, un régime où la souveraineté du roi est tempérée par la loi. Mais à l’intérieur du cercle de la légitimité, la souveraineté du roi n’est pas limitée. »
Il distingue 4 lois fondamentales principales :
• loi de catholicité
• loi de sacralité
• loi d’inviolabilité
• loi de masculinité
Loi d’inviolabilité est la plus importante pour ce que j’ai dit précédemment, car elle renforce l’autorité du monarque. Mais elle nous intéresse moins directement pour les limites à cette autorité que la loi de catholicité. En effet, cette dernière est une limité directe au pouvoir arbitraire car d’elle découle la filiation du monarque et de la monarchie en générale à l’Église catholique, et à sa doctrine ou à sa morale.
En fait, Basse ne fait ici que nous redonner des principes fondamentaux connus depuis longtemps. Dès le XVIème siècle, des écrivains, tels Loyseau dans Des seigneuries, notaient « Il y a trois sortes de lois qui bornent la puissance des souverains sans intéresser la souveraineté, à savoir les lois de Dieu, les règles de la justice naturelle et non positives et les lois fondamentales de l’État ». Et, nous le voyons ici encore, les lois de Dieu viennent en premier. A la fin du siècle suivant, Fénelon, dans les aventures de Télémaque, ajoutait que « l’autorité du roi est celle des lois. Il faut qu’il leur obéisse pour en donner l’exemple à ses sujets ». En effet, si le roi ne respectait rien, comment pourrait-il imposer quelque loi que ce soit ? Par exemple, comment un roi franc-maçon pourrait-il être à la tête d’une monarchie catholique sans lui faire perdre de sa crédibilité ? Je ne veux évidemment pas dire que le roi doit être absolument parfait, car il reste homme, mais ce doit théoriquement être le meilleur des hommes, voire un homme au-dessus des hommes. Surtout que les Français, qui parfois peuvent avoir une réputation de « fiers bovins », ont besoin d’exemples. Et quel pourrait être meilleur exemple sinon celui de leur chef, leur « tête » [caput] étymologiquement ?
De fait, les lois fondamentales du royaume donnent des engagements au souverain, comme lui enseignait l’ordo du sacre, qui est en quelque sorte leur concrétisation. Prenons quelques exemples dans l’Ordo dit « de Saint Louis », vers 1250.
Le roi devait à cette occasion déclarer solennellement devant clergé, noblesse et tiers réunis : « Je promets trois choses au nom du Christ au peuple chrétien, et qui m’est soumis : en premier lieu que le peuple chrétien tout entier garde en tout temps une paix véritable, sous notre contrôle, à l’Église de Dieu. En second lieu j’interdirai toutes les rapines et injustices. Troisièmement, je promets de prescrire le respect de l’équité et de la miséricorde dans tous les jugements »; puis encore « Je déclare et promets devant Dieu et ses anges de faire et conserver dorénavant de mon mieux la loi et la justice, ainsi que la paix à la sainte Église de Dieu et au peuple qui m’est soumis, dans le respect dû à l’Église, du mieux qu’il me sera possible de trouver avec le conseil de nos fidèles – et également de manifester les égards canoniques dus aux prêtres des églises de Dieu, et de conserver inviolablement aux églises qui me sont confiées tout ce qui leur a été accordé et alloué par les empereurs et rois; et enfin de donner aux abbés, comtes et à nos vassaux les honneurs qui leur sont dus, suivant le conseil de nos fidèles. » Notez qu’en plus des engagements pris, ces déclarations donnent aux pouvoir monarchique une dimension sacrale.
Toutefois, ces limites s’expliquent facilement. Je disais en introduction que le système monarchique était le plus équilibré. Et ces limites ne sont pas étrangères à l’équilibre, car sans elle, la monarchie, qui est le meilleur des régimes, peut devenir le pire, sous les traits de la tyrannie, comme le disait déjà saint Thomas d’Aquin. Nous le reverrons ultérieurement. De plus, il ne faut jamais perdre de vue que le roi est seulement dépositaire de la couronne, et qu’il n’a aucun droit personnel ou individuel sur le royaume. Lors du sacre, il lui est demander de bien vouloir « régir » le royaume, ce à quoi le roi répond « je le veux », et non de se l’approprier.
En fait, ces quelques règles, toutes simples, imposent en quelque sorte un ordre moral nécessaire à la fois au monarque et à la société, et auxquelles doivent se conformer à la fois le monarque et la société. C’est par exemple pour respecter cette morale qu’existe la loi de catholicité, comme nous l’explique Yves-Marie Adeline dans Le Pouvoir Légitime : « un ordre politique suppose un ordre moral qui, en dernière mesure, le justifie, car la direction de la cité devra obéir aux principes moraux sur lesquels les citoyens accordent leurs existences respectives, et en vertu desquels ils ont rassemblé leurs personnes en communauté, d’autre part.
En d’autres termes, la légitimité du pouvoir, considérée tout d’abord du seul point de vue politique, ne connaît son plein épanouissement que dans la mesure où la souveraineté répond aux exigences morales de la cité. Les Lois Fondamentales ne manquent pas d’ailleurs de la prévoir, qui privent de la succession dynastique tout Prince s’excluant de la profession de foi commune. La morale devant logiquement éclairer l’exercice du pouvoir, il est ainsi inévitable que la légitimité politique y soit attachée. »
Les lois fondamentales du royaume sont nettement plus à même d’assurer la stabilité de l’État qu’une constitution, dont les articles sont multipliés jusqu’à la dilution, voire parfois en contradiction avec la loi publique. Alors que les lois fondamentales sont quant à elles suffisamment précises pour être des gardes-barrières efficaces, mais pas multipliées jusqu’à perdre leur sens.
L’importance des instances de conseil
La nécessité de déléguer, comme le déclarait le marquis d’Argenson, a pour corollaire celle d’être conseillé. Je viens de dire que tout monarque qu’il était, le roi n’en reste pas moins hommes, et de fait ses compétences directes sont limitées. La nécessité de conseil doit pallier à cette insuffisance.
Il y a là-dessus un consensus chez les auteurs. Dès le XIIIème siècle, le sire de Beaumanoir écrivait déjà que « Pour les établissements, le roi doit moult prendre garde qu’il les fasse par grand conseil ». Quelques siècles plus tard, Louis Antoine Séguier, avocat du roi au Parlement de Paris, déclarait de même, quoique de façon un peu plus revendicative. Lors de la séance du 7 décembre 1770, sous le règne de Louis XV donc, il dit : « Votre Parlement, Sire, ne cherchera jamais à s’écarter du respect et de la soumission due à votre autorité royale. S’il multiplie quelquefois ses remontrances et ses représentations, c’est que votre autorité elle-même, quelle qu’en soit l’étendue, se plaît à se laisser tempérer par la bonté. Les rois sont les images de Dieu sur la terre, et la Divinité ne craint pas d’être importunée par les prières ».
Et les rois, qui ne sont pas plus stupides que les autres, le savaient évidemment, et ont toujours pris conseil.
Charles V, dans une ordonnance d’octobre 1374, écrivait « Nous et nos prédécesseurs, nous fûmes toujours gouvernés et gouvernons en tous nos faits par grand nombre de sages hommes, clercs et laïcs ». Henri II, dans un édit de janvier 1551, réitérait « Après avoir mis ce fait en délibération de notre conseil privé, par l’avis de celui-ci, avons dit, déclaré et statué », etc. Et ce ne sont là que deux exemples parmi d’innombrables.
Il existait différentes instances principales de conseil:
• d’abord le conseil du roi, qui était composé des proches du roi et autres grands seigneurs, clercs ou laïcs, mais aussi de conseillers choisis exclusivement pour leur compétence.
• puis les Parlements, comme celui du Languedoc à Toulouse dès 1420, celui du Dauphiné à Grenoble dès 1455, ou encore celui de Dijon dès 1489, qui par exemple pouvaient guider le roi par leurs remontrances.
• enfin les États généraux, bien connus dans la mesure où la réunion des derniers fut funeste pour monarchie. Mais la réunion régulière de ces derniers était essentielle pour l’équilibre du système car les États était la lien le plus direct entre le monarque et la nation, à l’heure où les médias n’étaient pas ce qu’ils sont maintenant. Ils étaient en quelque sorte le moyen de tester l’opinion.
Mais tout ceci n’est pas sans danger.
Des dérives dangereuses : du conseil à l’omnipotence
Bodin écrivait encore qu' »il y a bien différence du conseil au commandement; le conseil de plusieurs bons cerveaux pour être meilleur qu’un, mais pour résoudre, pour conclure, pour commander, un le fera toujours mieux que plusieurs ».
Une telle déclaration est à mille lieues du 22 juin 1789, date à laquelle les États généraux réunis par Louis XVI le 1er mai prennent le titre d’ « Assemblée nationale » et répondent au roi, quand il demande leur séparation, que « la nation assemblée ne peut recevoir d’ordre ». Cet exemple, peut être le plus marquant de l’histoire de France, nous montre la principale dérive des instances de conseil.
En effet, l’équilibre est rompu lorsque l’une ou l’autre des parties outrepasse ses droits: le monarque doit être conseillé évidemment, nul ne dira le contraire, mais il doit aussi garder son pouvoir de décision (ayant toujours le Bien Commun à l’esprit bien sûr). Et ce pouvoir de décision doit être plus que régler les litiges entre deux tendances au parlement ou durant la réunion des États. Il doit être pleinement le chef de l’exécutif, et non pas un simple arbitre dont nul n’écouterait les avertissements. Ainsi, si la « représentation nationale » conseille majoritairement une loi en faveur de l’avortement, le roi doit avoir les moyens de décider de ne pas suivre ce conseil, pour le Bien commun qui, comme j’ai coutume de le dire, est une loi bien éloignée de la loi de la majorité.
Ainsi, le principe monarchique est largement tempéré, et lorsque nul ne sort de ses attributions propres, c’est certainement le système le plus équilibré. Par conséquent, c’est aussi le plus actuel.
Actualité du principe monarchique.
Le mythe du tyran parce que monarque
Considérant les dérives dont je viens de parler, vous me direz : mais n’y a-t-il pas plus de risques qu’il y ait dérive du côté du roi, et que le monarque devienne tyran ? Et il est même bien légitime de se poser la question du « roi-dictateur », dans la mesure où nous avons vu que son pouvoir était quasi-illimité, et que somme toute ces limites qui sont un frein à l’absolutisme ne sont des limites que parce que le souverain y donne son consentement. Bien facile pour lui de les dépasser et de n’agir que selon son intérêt personnel.
De plus, il est vrai certaines attitudes de nos rois peuvent être ambiguës. Je citais tout à l’heure Henri IV entendant bien se faire obéir. Il pourrait vite passer pour un tyran. De même, si nous prenons au pied de la lettre une déclaration comme celle de Louis XIV, dans Mémoires et instructions pour le dauphin, à savoir « celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu’on les respecta comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d’examiner leur conduite », alors, nous serions encore tenter de crier « halte au tyran ».
Il est courant en France de dire d’eux que c’étaient des « monarques absolus », au vu de l’importance de leurs attributions, et considérant d’ailleurs davantage les dérives à leur pouvoir que les fondements. Alors, la question est simple : pouvons-nous parler à juste titre d’absolutisme ?
Pour y répondre, nous pouvons nous référer à un homme plus proche de nous que Louis XIV ou Henri IV, mais tout aussi décrié actuellement par la pensée unique. Il s’agit du pape Pie XII, qui dans son radiomessage sur la démocratie du 24 décembre 1944, enseignait que « l’absolutisme d’État[…]consiste en effet dans le principe erroné que l’autorité de l’État est illimitée, et qu’en face d’elle – même quand elle donne libre cours à ses vues despotiques, en dépassant les frontières du bien et du mal – on n’admet aucun appel à une loi supérieure qui oblige moralement. » Alors, pouvons-nous décemment dire que sous l’Ancien Régime la monarchie était absolue ? bien évidemment non, dans la mesure où la race capétienne était, et reste, la race des rois très chrétiens, y compris Louis XIV d’ailleurs.
Et Pie XII de poursuivre : « Un homme pénétré d’idées justes au sujet de l’État, de l’autorité et du pouvoir dont il est revêtu en tant que gardien de l’ordre social, ne pensera jamais à léser la majesté de la loi positive dans les limites de sa compétence naturelle. » Nous touchons ici un point essentiel : le gouvernement pour le Bien commun, qui concerne évidemment plus facilement le système monarchique que le système républicain.
Et j’aurais presque tendance à dire quand bien même, à la suite de saint Thomas d’Aquin dans son De Regno lorsqu’il nous dit que « De la monarchie, quand elle se tourne en tyrannie, il sort un moindre mal que du gouvernement de plusieurs nobles, lorsqu’il se corrompt.
En effet, la discorde, qui sort principalement du gouvernement de plusieurs, est contraire au bien de la paix, c’est-à-dire au bien capital de la société. Mais la tyrannie ne supprime pas ce bienfait, elle se borne à empêcher le bien d’un plus ou moins grand nombre de particuliers » Alors que « lorsque la discorde s’est élevée au cœur du gouvernement collectif, il arrive souvent que l’un des gouvernants, s’imposant à ses collègues, s’approprie le pouvoir sur la multitude »
« Si donc la royauté, qui est le meilleur gouvernement, semble devoir être évitée surtout à cause de la tyrannie, celle-ci en revanche se rencontre non pas moins, mais plus facilement dans le gouvernement de plusieurs que dans le gouvernement d’un seul : il en résulte tout simplement qu’il est plus avantageux de vivre sous un seul roi que, sous un gouvernement collectif »
« Il peut arriver aussi que la multitude ayant chassé le tyran grâce à un meneur quelconque, celui-ci reçoive le pouvoir, s’empare de la tyrannie, et, craignant de souffrir ce que lui-même vient de faire à autrui, écrase ses sujets sous une servitude encore plus lourde que la première »
« si le droit de pourvoir le peuple d’un roi appartient à une autorité supérieure c’est d’elle aussi qu’on doit attendre un remède contre la scélératesse du tyran »
Nous voyons donc chez saint Thomas d’Aquin que déjà il vaut mieux une tyrannie monarchique qu’une tyrannie républicaine (ce qui est évidemment une façon de parler), et nous pourrions nous arrêter là car déjà nous aurions montrer qu’il vaut mieux un monarque qu’un président de « République démocratique », mais plus intéressant encore le fait que déjà en son temps saint Thomas d’Aquin nous éclairait quant à la facile corruptibilité du gouvernement de plusieurs. Il n’eut certainement pas voté pour Chirac !
Par conséquent, vous voyez que faire de nous des partisans d’une dictature atroce, ou des adversaires acharnés des droits de l’homme, dans le sens que leur donne notre pseudo-démocratie, est tout simplement ridicule.
Adversaires de leurs droits de l’homme, nés de la Révolution, oui, nous le sommes évidemment. Et jamais nous ne pourrions soutenir des articles comme l’article 3, dans lequel nous lisons que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » En effet, nous ne pouvons qu’être éloignés du mythe de la « nation déesse », du mythe de cette nation ne reconnaissant d’autre dieu qu’elle-même et d’autre religion que la démocratie. Et nous sommes tout aussi éloigné de l’article 6, nous enseignant que « la loi est l’expression de la volonté générale ». Mais pouvons-nous ici parler de droits de l’homme, alors qu’ils ne font que prêcher un système politique, sans considérer la liberté humaine, ni la plénitude de l’homme (avec sa dimension spirituelle).
Et il ne faut pas oublier que déjà en 794 le concile de Francfort, oeuvre d’un grand monarque, Charlemagne, sur l’impulsion et le conseil de son Ministre de l’Instruction Publique, le moine Alcuin déclarait que l’Homme était souverain, non pas selon la triste loi de la majorité révolutionnaire, mais parce que créé à l’image de Dieu. Tout homme est donc libre.
Ainsi, parler du « tyran parce que monarque » relève bel et bien du mythe ou de la fabulation, et relève plus d’attaque de bas-étage de la part d’hommes qui ne souffrent aucune opposition malgré leurs beaux droits de l’homme tout reluisants !
L’hypocrisie égalitariste ou le mythe démocratique
L’esprit « moderne » est ancien, c’est-à-dire qu’avant la Révolution il était, mais qu’après il put s’épanouir jusqu’à ce que nous en fassions un système. Léon XIII, en juin 1881, déclarait que « c’est de la Réforme que naquirent, au siècle dernier, et la fausse philosophie, et ce qu’on appelle le droit moderne, et la souveraineté du peuple, et cette licence sans frein en dehors de laquelle beaucoup ne savent plus voir de vraie liberté »
Nos adversaires ont-ils vraiment tort ? Est-il mauvais de vouloir fonder soi-disant la société sur l’égalité, d’où découle apparemment la liberté ?
Le plus gros reproche fait au monarque est d’être sinon au-dessus des autres, du moins à leur tête, ce qui est dans la logique de lutte des classes déjà la marque du tyran, et comme chacun sait, les démocrates ne supportent pas les tyrans, du moins s’ils ne sont pas de leur bord ! Le monarque n’est pas assez égalitaire pour l’idéologie démocratique.
Toutefois, si nous sommes égaux devant Dieu, nous ne le sommes évidemment pas dans la vie: certes il n’y a plus de monarque, mais il y a néanmoins toujours une classe dirigeante (que je n’appellerai pas aristocratie, car cette dernière correspond au gouvernement des meilleurs !). Et c’est encore pire, car, si nous nous conformons à leur logique, le monarque ne serait qu’une seule personne privilégiée, alors que dans leur système républicain, c’est tout un groupe qui l’est. Et c’est par conséquent encore plus injuste !
J’espère que c’est un manque de lucidité de Marianne lorsqu’elle se fait prêtresse de la déesse égalité, et non un manque d’honnêteté. Mais permettez-moi d’avoir des doutes en ce domaine.
Dans une société, l’égalité ne peut être qu’hypocrisie. C’est encore ce que nous enseigne Léon XIII dans Rerum Novarum, en mai 1891 : « il est impossible que, dans la société civile, tout le monde soit élevé au même niveau[…]Cette inégalité d’ailleurs tourne au profit de tous, de la société comme des individus; car la vie sociale requiert un organisme très varié et des fonctions fort diverses; et ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions, c’est surtout la différence de leurs conditions respectives ». « Quelles que soient les vicissitudes par lesquelles les formes de gouvernement sont appeler à passer, il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une société ne peut ni exister ni se concevoir »
Les monarchistes ont au moins cet avantage de ne pas faire d’hypocrisie : nous n’avons jamais été prophètes d’une égalité civile qui n’existe pas. Et preuve en est que nous n’avons pas peur qu’un seul homme incarne le pays tout entier, qu’un seul homme soit le trait d’union entre les inégalités en quelque sorte !
Pie XI, dans Divini Redemptoris, en mars 1937, va même plus loin que Léon XIII en condamnant ouvertement l’hypocrisie égalitariste : « C’est une erreur grave de prétendre que tous les citoyens auraient des droits politiques égaux et qu’il n’existerait point de hiérarchies légitimes dans la société civile »
Reste à définir quelle serait la meilleure hiérarchie.
Nous pouvons pour ce faire utiliser une image simple. Pour être parfaite, la société doit-être comme une pyramide, dans laquelle nous ne gravirions pas les marches tant que tout l’étage inférieur n’a pas été visité. C’est là-encore le principe de subsidiarité.
Alors la République démocratique et socialiste correspond-elle au schéma pyramidal ? Presque, mais c’est une pyramide inversée, et cette différence est cruciale : tout vient d’en haut, c’est à dire de l’État, au nom du peuple. Et ce peuple, aussi nombreux soit-il, devient irrémédiablement une minorité ignorée à mesure que l’État agit pour lui-même, c’est-à-dire pour les quelques personnes qui détiennent le pouvoir, et toute la pyramide.
La monarchie quant à elle est une pyramide « simple » : tout remonte vers le monarque. Certes un reproche est possible : tout vient d’en haut aussi puisque un monarque est à la tête de l’État ! Mais faire un tel reproche serait négliger l’importance des corps intermédiaires sans lesquels le monarque, qui n’est pas si seul qu’il pourrait le paraître, ne saurait gouverner.
Persistance et continuité d’un pouvoir monarchique
En revanche, quoique n’étant pas seul, le roi est bien évidemment un facteur d’unité nationale. Et ce rôle, qui est loin d’être secondaire et prend encore plus de relief aujourd’hui, à l’heure où la nation est en déliquescence au sein de la superbe Europe, est ancien. C’est ce qu’affirme par exemple Joël Cornette, dans l’affirmation de l’État absolu 1515-1652 : « dans ce royaume-mosaïque, la notion de nation ne pouvait se concevoir indépendamment de la personne physique du roi, seul principe et « réalité » d’unité. Chaque période de minorité ou de vacance du pouvoir qui mettait en jeu la continuité de l’État, fut ponctuée de révoltes et de contestations : guerres de Religions après la mort d’Henri II, guerres menées par les grands, chefs de lignages aristocratiques, au début du règne du jeune Louis XIII, Fronde au moment de la minorité de Louis XIV. »
Il est vrai que nous touchons là un des avantages de la royauté, encore actuellement. Pour preuve, il suffit de regarder la différence d’attitude vis-à-vis de l’Europe entre la France républicaine, et l’Angleterre, toujours unie derrière la famille royale (et quoi que l’on puisse penser de cette dernière).
En fait, le roi permet de mettre un visage au royaume. « Un des avantages primordiaux de la monarchie, c’est qu’elle est, en chair et en os, une réalité vivante, c’est la personne du roi », écrit très justement Léon Daudet dans ses Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux.
En ce sens, le roi est aussi facteur d’unité au sein du pays. C’est-à-dire non pas seulement face à un ensemble plus vaste que la nation, mais aussi entre différents corps au sein de cette nation. Et c’est ici en complet décalage avec des thèses comme celles de Marx, dans son Manifeste du Parti Communiste : « le pouvoir politique, a proprement parler est le pouvoir organisé d’une classe pour l’oppression d’une autre » ou de son successeur Lénine, dans l’État et la révolution » : « L’Etat c’est l’organisation de la violence destinée à mater une certaine classe » « les contradictions de classe sont inconciliables ».
Là aussi, il faut rappeler l’importance de l’apport du christianisme, et donc du fait que le monarque doive être catholique selon les lois fondamentales du royaume, car lorsque la « fraternité » prolétarienne se fait toujours sur le dos de l’un ou de l’autre, la charité nous unit tous, parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et le monarque, garant du salut de son peuple, doit donc faire encore plus d’efforts en ce sens.
Ce rôle du monarque trait d’union national est évidemment majeur, et d’autant plus actuellement je viens de la dire. Mais ce n’est bien sûr pas là le seul avantage qui fasse de la monarchie un système d’avenir. J’en citerais plus brièvement quelques autres, qui sont évidents.
Déjà, il faut rappeler la continuité politique qu’apporterais la monarchie, et qui manque cruellement aujourd’hui. Comment est-il possible en politique d’ignorer à ce point la longue durée ? Certes, nous pouvons comprendre nos dirigeants actuels : une politique de longue durée va souvent à l’encontre du bien immédiat, et penser aux enfants ne sert pas forcément les parents. Hors, les échéances électorales font qu’il vaut mieux pour nos élus républicains aller à l’immédiat. Et aller vers quelques intérêts particuliers aussi, car lorsque le Bien commun ne se quantifie pas, ces intérêts particuliers se comptent quant à eux en voix aux élections. Le roi, n’étant évidemment pas élu, échappe à ces travers et peu se permettre plus de rigueur politique, pour le bien de tous.
Rappeler que par définition le roi n’est pas élu, c’est aussi rappeler un autre avantage majeur du système que nous défendons, à savoir l’indépendance du monarque. Comme nous le dit Maurras, la démocratie est le système des partis. Et par le biais des élections, des pressions diverses qui s’exercent (des médias aux franc-maçons, en passant par les lobbies homosexuels ou autres marginaux), le chef de l’État comme le gouvernement n’ont pas grande latitude pour appliquer une politique souhaitable. Ce à quoi échappe encore le monarque bien sûr dans la mesure où il ne doit à personne le pouvoir qu’il détient, sinon à Dieu.
De plus, j’insisterais encore sur l’importance de concentrer les différents pouvoirs afin d’assurer une certaine efficacité politique, et par définition sur l’importance d’avoir un monarque bien sûr. C’est une logique très simple, abordable par tous : celui qui fait les lois les met en oeuvre et contrôle leur application. Vous voyez ici que c’est le lien de toute ma première partie. Mais il ne faudrait pas le sous-estimer, car cela évite le problème d’incompatibilité des vues de chacun, comme vous pouvez vous en doutez, incompatibilité qui paralyse tout le système. Le visage politique français est en ce domaine des plus expressifs !
Et il faut que le monarque détienne tous les pouvoirs sans partage (ce qui ne veut pas dire sans délégation). L’opposition Chirac/Jospin est révélatrice et prêche pour nous : c’est une sorte de concurrence médiatique où le premier doit dire l’inverse du deuxième , le deuxième écraser le premier pour préparer les élections suivantes, etc. Bref, c’est un charabia qui semble bien loin de l’intérêt de la France.
Toutefois, il faut bien admettre que cette idée de concentration des pouvoirs fait peur : « et si le monarque fait n’importe quoi, nous sommes cuit ! », nous dit-on ! Mais pourquoi le monarque ferait-il n’importe quoi ? Est-il forcément moins compétent qu’un président élu ? Certainement pas : il se prépare toute sa vie à régner, ce qui est une scolarité encore plus longue qu’à l’ENA, et, comme le dit Maurras, « il n’est pas indifférent que le roi et les princes soient de bonnes gens et des gens capables » ! Alors peut-être le monarque, se sachant en place pour toute sa vie, pourrait-il volontairement faire n’importe quoi ? Mais où y trouverait-il son intérêt ? Lisons une fois de plus Maurras, dans Mes Idées politiques : « Un roi détrôné devient un exilé misérable. Un républicain qui a perdu le pouvoir est un grand personnage qui ne perd jamais l’espérance d’y revenir et qui vit entouré d’une cour de parasites actifs et remuants. C’est pourquoi si un roi est à la fois âpre et prudent au bien public, parce qu’il perdrait beaucoup à manquer de l’une et l’autre de ces qualités, le républicain ne perd grand-chose ni à tout risquer, ni à tout négliger : il peut même se dire en tombant qu’il saura toujours tout rattraper et réparer la prochaine fois ! » Et Maurras n’a pas tort : regardez quelqu’un comme Tapi, qui fait son grand retour à Marseille !
Entre république et monarchie, le choix est donc facile à faire.
Conclusion : pour l’avenir ?
Je n’ai cité ici que quelques avantages sommaires du système monarchique. Mais déjà, vous pouvez voir que ce système est certainement plus actuel, par la solidité de son principe, que celui sous le joug duquel nous vivons. Et nous sommes loin d’avoir fait le tour de tous ses avantages; il faudrait bien plus d’une conférence pour cela.
Vous voyez que par conséquent nous ne sommes pas aussi marginaux que l’on voudrait souvent nous le faire croire. Et nous sommes même à l’heure actuelle la seule école politique pensant avec réalisme, simplicité et efficacité à l’avenir de la France.
Reste à faire connaître ce qu’est le principe monarchique, car il n’aura échappé à personne qu’il est largement ignoré. Et nous devons donc d’autant plus tenir bon dans notre combat. Ce qui ne doit pas nous empêcher d’être optimistes : le système actuel ne cesse de nous donner des encouragements, des divisions entre des partis qui fondamentalement pensent pareils mais se paralysent l’un l’autre par principe, à un chef de l’État qui théoriquement est au-dessus des partis mais qui n’a jamais autant prêché pour ses larbins que depuis qu’il est président, et qui risque de bientôt retrouver d’autres larbins à la Santé, en passant par toutes les lois qui font avancer à grande vitesse la France dans le mur… Bref, la France est foutue, tant mieux pour nous, nous aurons au moins quelque chose à reconstruire !
Mais si nous voulons être efficaces, il faut déjà que nous soyons formés, et vous savez que c’est une chose à laquelle je tiens. Il faut être formé pour pouvoir enseigner aux nations… « On ne peut pas passer tout son temps à donner des coups de poing, les occasions de manifester ne sont pas, bien que fréquentes, continuelles; c’est par conséquent l’étude approfondie et sans cesse plus fouillée de nos doctrines et de l’histoire qui, seule, peut nous tenir en haleine ». Voilà qui est riche d’actualité, et loin de l’esprit « camelot » me direz-vous, et pourtant cet enseignement était celui donné aux jeunes d’Action Française lors de leur quatrième congrès. Comme quoi, nous sommes sur la bonne voie. Alors, pour finir court je ne dirai que deux fois deux mots : « tenons bon » et « mobilisons-nous »!
David M.
Président du Cercle des Cadets du Lyonnais
Conférence du 3 mai 2001.
2001 © Cadets du Lyonnais
Association régie par la loi du 1er juillet 1901.