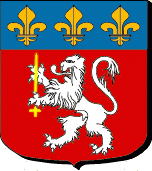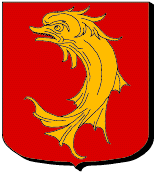Classé Trésor national, le bureau de Louis XIV a retrouvé sa place dans le salon de l’Abondance du château de Versailles (Yvelines) après sa restauration.
Il avait été acquis en 2015 par le château par préemption, grâce au mécénat d’Axa et de la Société des Amis de Versailles, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation du patrimoine.
7 ans de recherches et de restauration
Le bureau a été l’objet d’un long travail de recherche et de restauration, mené au sein du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), sous l’égide d’un comité scientifique international.

Un frère jumeau
Ce bureau a une longue histoire. En 1685, Alexandre-Jean Oppernordt, ébéniste ordinaire du roi depuis 1684, livre pour le château, à la demande des Bâtiments du Roi, une paire de bureaux brisés en marqueterie d’écaille et de laiton.
Ces bureaux, dont le décor de l’un forme le négatif de l’autre, étaient destinés à la pièce de travail de Louis XIV dans ses petits appartements.
Mais ce type de bureau, dont le plateau articulé s’ouvrait par le milieu, fut jugé peu pratique et démodé. Les bureaux furent replacés dans le garde-meuble de la couronne avant d’être vendus aux enchères en 1751 sous le règne de Louis XV. Les bureaux vont alors être séparés.
Metropolitan Museum de New York
Sans avoir subi de transformation, le premier d’entre eux est présenté depuis 1986 au Metropolitan Museum de New York.
Le second a été transformé en bureau en pente à gradins à une date indéterminée et se retrouve en Angleterre au XIXe siècle, dans les collections du baron Ferdinand de Rothschild (1839-1898).
C’est ce second bureau qui est entré dans les collections du château de Versailles en 2015, ayant conservé son décor, dont le plateau à l’iconographie célébrant la gloire du Roi Soleil.
À partir de 2015, un comité scientifique international a été créé pour étudier le meuble et s’interroger sur sa restauration. Il a finalement été décidé de redonner à l’œuvre sa forme originelle de bureau brisé du XVIIe siècle.
HISTOIRE DETAILLEE DE CE BUREAU ET DE SA RESTAURATION
Ils sont deux. Deux bureaux issus du même atelier, celui de l’ébéniste Alexandre-Jean Oppenordt (1639-1715), qui avait reçu commande, avant juin 1685, des « compartimens » pour les « deux bureaux du petit cabinet de Sa Majesté ». Autrement dit, des panneaux qui recouvriraient les meubles plaqués d’ébène et de bois de rose du Brésil, et dont le dessin avait été composé par le dessinateur de la Chambre du roi, Jean Ier Berain (voir Gazette n° 14 du 9 avril 2021, page 166). La somme de 240 livres était réglée le 25 juillet à l’ébéniste pour ce travail. Fils d’un boucher de Gueldre, en Hollande, Alexandre-Jean Oppenordt (voir Gazette n° 7 du 18 février, page 154), arrivé à Paris dans les années 1655-1660, avait appris le métier dans l’atelier de l’ébéniste César Campe et travaillait depuis quelques mois pour le service des Bâtiments du roi. L’un des bureaux fut habillé en première partie de marqueterie : le chiffre de Louis XIV et le décor, en laiton, se détachaient sur le fond d’écaille teinté d’écarlate. Il est aujourd’hui conservé au Metropolitan Museum of Art à New York. L’autre, vêtu de la marqueterie en contrepartie, possédait donc les mêmes motifs, mais inversés, l’écaille rouge formant le dessin dans les vides laissés par les plaques de laiton. Celui-ci vient de retourner dans sa demeure d’origine, le château de Versailles. « Bien que très prisée alors par les milieux d’ébénistes parisiens, écrit l’historien d’art Calin Demetrescu dans Les Ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV (La Bibliothèque des arts), l’écaille rouge fut jugée visiblement peu appropriée pour un meuble royal, et Oppenordt fut loin de remporter le succès escompté : malgré la qualité extraordinaire de son travail, ce fut la dernière commande de mobilier qu’il recevait pour la couronne. » Ces deux bureaux à huit pieds ornés de bronzes dorés, où le chiffre du roi était présent jusque sur les entrées de serrure des tiroirs latéraux, de ceux des caissons du milieu et des trois tiroirs feints de la ceinture, étaient dit « brisés » parce que leur plateau, articulé, s’ouvrait en deux parties, laissant place à un intérieur formant une écritoire et quatre tiroirs. Ils étaient destinés au Petit cabinet octogonal, aménagé deux ans plus tôt en « Cabinet où le roi écrit », derrière la galerie des Glaces. Ils sont décrits ainsi dans l’Inventaire général de 1729, « de marqueterie d’écaille de tortue et de cuivre, représentant au milieu les chiffres du Roy couronnés et surmontés d’un soleil, et à chaque coin une grande fleur de lys, ayant par devant neuf tiroirs fermans à clef, portés sur huit piliers en gaine de même marqueterie à bases et chapiteaux de cuivre doré ». Passés de mode, ils furent vendus aux sieurs Joubert et Centenier le 12 juillet 1751, lorsque Louis XV ordonna de disperser les anciens meubles de la couronne.

Au chevet d’un chef-d’œuvre
L’un des deux a donc fini par intégrer le Metropolitan Museum. On trouve trace du second dans la collection de Ferdinand de Rothschild à Londres, au XIXe siècle, puis dans celle de lady Ripon et enfin de sa fille Juliet Duff. Vendu chez Sotheby’s en 1969, il entra dans la collection de la famille Servier, et fut à nouveau mis aux enchères à Paris le 18 novembre 2015. Classé Trésor national, interdit de sortie du territoire, il a été préempté 1 487 200 € (voir Gazette 2015 n°41, page 187) par le Musée national du château de Versailles grâce au mécénat d’Axa et à la Société des amis de Versailles, en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Modifié en bureau à pente sans doute avant même qu’il ne soit acquis par Ferdinand de Rothschild, il a été restitué depuis dans sa forme d’origine, une décision très rare qu’explique Laurent Salomé, le directeur du musée : « L’acquisition s’est faite déjà du temps de mon prédécesseur, Béatrix Saule, avec l’idée de le rétablir dans sa forme parce que ce bureau, ainsi transformé, était difficile à intégrer dans le parcours. L’étude du comité scientifique à partir de 2017 n’a fait que confirmer ce choix. Nous nous sommes rendu compte que le dernier état du meuble était peu intéressant, mal documenté. La réalisation n’était pas de bonne qualité. Pourtant, malgré ce traumatisme, le décor a été plutôt moins restauré que celui du bureau conservé au Metropolitan Museum. Lorsque nous avons compris que nous pourrions récupérer énormément de décors avec très peu de perte, notre décision de le restituer dans sa forme d’origine a été confirmée. » L’étude préalable pour affiner les partis pris de restauration a duré deux ans, pendant lesquels les conservateurs du comité scientifique – dont Danielle Kisluk-Grosheide, conservatrice en chef au Metropolitan Museum de New York – sont venus à plusieurs reprises examiner le bureau au département des Arts décoratifs du laboratoire des musées de France, le C2RMF. Quarante pièces ont été examinées, des radios ont permis de découvrir que les chênes ayant servi à sa fabrication avaient été abattus après 1680, ce qui tend à prouver que les ébénistes travaillaient avec du bois vert, contrairement à ce que l’on pensait. « Sur le plateau, nous avons retrouvé les traces de vis qui formaient les anciens pivots, explique Frédéric Leblanc, chef des travaux d’art. Dans toutes les restaurations, il y a une surprise. Dans celle-ci, ce fut de découvrir que toutes les marqueteries de laiton avaient été refixées au XXe siècle avec une colle époxy à base d’Araldite. » Il a fallu retirer cette colle avec un scalpel à ultrason, un travail long et minutieux, avant de tout recoller avec une colle animale réversible. Ce contretemps a cependant permis aux restaurateurs d’étudier les traces d’outils au revers des éléments de marqueterie, et de différencier les pièces d’origine des autres.

Une restauration scrupuleuse
Les parties hautes ajoutées pour réaliser l’abattant en pente du bureau ont donc été supprimées et leur marqueterie replacée sur les faux tiroirs de la ceinture. Pour restituer les lacunes (10 à 15 % du décor), des dessins ont été tracés en copiant les motifs du bureau conservé au Metropolitan Museum. Ils ont ensuite été vectorisés, selon une technique mise au point par Frédéric Leblanc pour agrandir les motifs sans les déformer, puis découpés avec un équipement laser spécifique. De minuscules traits ont été gravés sur certaines pièces de marqueterie et le revers des parties neuves en laiton a été traité différemment des anciennes, afin que les restaurateurs futurs puissent comprendre les travaux effectués sur le meuble. Les vernis, très épaissis, ont été remplacés pour raviver les teintes de l’écaille de tortue. À l’intérieur de l’abattant, enfin, sous le cuir rouge qui avait été ajouté, un placage a été réalisé selon la technique du frisage en fougère, qui joue avec les dessins des essences de bois. Après plus de cinq ans passés au C2RMF, le bureau de Louis XIV, remis à plat, vient de retourner au château, installé depuis le 20 novembre dans le salon de l’Abondance, non loin de l’emplacement de l’ancien Cabinet où il avait été livré, à l’été 1685. Au soulagement de Laurent Salomé, très heureux de l’accueillir : « Ce bureau est resté très longtemps en restauration, nous sommes contents qu’il ait enfin rejoint sa destination définitive ! »
Source : https://www.gazette-drouot.com/article/un-bureau-de-louis-C2-A0xiv-de-retour-a-versailles/40473
Il a fallu attendre 271 ans pour que ce bureau réintégre le château de Versailles où il était entré en 1685 – puis vendu en 1751, pour être classé monument historique en 2015